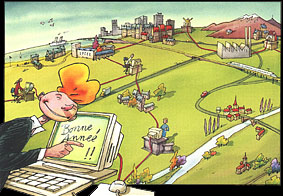![]()
Recevoir Mazan dans nos colonnes est à la fois un plaisir et une frustration. C’est un plaisir car le personnage est vraiment intéressant par sa personnalité, son travail et ses réflexions, mais une frustration par le peu de place que nous avons à lui consacrer. Mazan nous a reçu chez lui, dans la campagne Angoumoisine et nous a ouvert ses cartons à dessin remplis de croquis, d’esquisses, de recherches de personnages, d’attitudes ou de costumes et d’illustrations en tout genre.
Mazan répond à de nombreuses autres questions dans Faille Temporelle 11. Vous y trouverez également plusieurs dizaines de croquis inédits ainsi qu'une BD (scénario de Marazano) inédite.

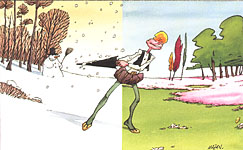
FT : Comme beaucoup d’autres chez Delcourt, tu sors du Nil (Beaux Arts d’Angoulême). D’ailleurs, beaucoup de tes copains de promotion vivent aujourd’hui de la bande dessinée.
Mazan : À l’époque, nos profs disaient que nous étions vraiment la dernière des sections. Il faut dire que nos aînés n’étaient autres que De Crecy, Chomet, Chevillard, O’Groj et compagnie. Ils étaient un peu “spéciaux” pour l’école et tout le monde pensait qu’ils plongeraient dans le monde de la bande dessinée en sortant de l’école. Au lieu de cela, ils se sont dirigés tout de suite vers le dessin animé. Dans ma promotion, il y avait Tiburce Oger, Jean-Luc Masbou, Turf, Jean Luc Loyer, Alain Ayroles, Eric Rémy et Johanna Shipper. Et finalement, si certains ont d’abord fait du dessin animé chez IDDH (Les Tortues Ninja, Denver le dernier dinosaure…), pratiquement tous ont réussi à faire de la bande dessinée. Moi, j’ai eu la chance d’avoir un contrat très vite. Juste après avoir reçu l’Alfred Avenir (NDLR : rebaptisé Alph’Art Graine de Pro) en 88.
FT : Le Grand Mal, ton premier album, est parti de l’histoire courte publiée dans Les Enfants du Nil.
Mazan : Oui. En fait, pour l’Alfred Avenir, il fallait fournir une histoire en trois planches. Je suis parti d’un reportage, sur la vie sur les plates-formes pétrolières, dans lequel se dégageait une sensation d’univers clos. Le personnel de ces plates-formes est enfermé pendant deux à trois mois et c’est cet aspect qui m’intéressait. Après avoir eu l’Alfred, Guy Delcourt est passé à l’école et m’a laissé sa carte de visite. Moi, je voulais faire des histoires courtes dans (A Suivre) ou Pilote pour me faire la main. Delcourt voulait un album de 46 pages, mais pour un étudiant en première ou en deuxième année, c’était lourd à gérer. Il m’a quand même relancé trois fois, et la dernière fois, c’était en juin 88 à Erlangen (NDLR : grand festival BD en Allemagne), j’ai accepté tout en lui disant que je n’avais pas d’idée précise sur ce que je pourrais faire. Il m’a laissé carte blanche. Comme je n’avais rien en poche, l’histoire publiée dans Les Enfants du Nil, qui, au départ, s’appelait Aménophis 4, m’a servi de base pour construire mon scénario. Entre temps, j’avais fais une seconde histoire courte de 6 pages qui s’appelait Le Grand Mal. J’ai groupé ces deux histoires et j’ai trouvé une fin pour en faire un album cohérent. Le problème, c’est qu’on sent bien que l’album est divisé en trois parties. C’est une erreur que je n’aurais certainement pas faite si j’avais conçu l’histoire d’un seul bloc.
FT : Avec ce premier album, tu es déjà bien engagé. Tu dénonces les manipulations d’un état sur son peuple.
Mazan : Tout cela part du rapport à l’actualité. En première année de bande dessinée, on avait un professeur qui s’appelait Philippe Sergent. Pendant les premiers mois de cours, chaque jour, nous devions soit lire le journal, soit regarder des reportages et faire un petit synopsis de trois ou quatre lignes en rapport avec l’actualité, qu’on avait le loisir de décliner comme on souhaitait. Chaque fin de semaine, en guise d’exercice, on devait choisir un de ces synopsis et en faire un scénario d’une ou deux pages. C’est également comme ça qu’est arrivé Lumière sur le Front. Tout est parti d’une nouvelle de Roland Barthes qui se situe lors de l’inondation de Paris en 1951. Il parlait de la modification des rues, des paysages et le changement d’état d’esprit des gens en fonction de la montée des eaux. J’en ai fait une petite histoire de 5 pages et de là, j’ai trouvé matière à la développer.
FT : Dans cet album, tu te sens plus proche de Paterne le déserteur, que de Victor, le cinéaste qui se sert de la guerre pour devenir célèbre ?
Mazan : Le problème de ce cinéaste, et c’est un peu mon problème aussi, c’est d’avoir l’impression d’avoir quelque chose à dire dans ce monde, d’avoir une pierre à apporter à l’édifice. L’idée de base est une fois de plus en rapport avec l’actualité de l’époque. Pendant la chute des Ceaucescu en Roumanie, tous les matins, je me suis planté comme un con devant la télé pour savoir comment les événements allaient évoluer et s’ils allaient se faire attraper. À la fin, quand on a vu les cadavres, je me suis rendu compte de l’absurdité du côté médiatique de cette guerre. On suit ça comme des imbéciles, comme on suivrait un feuilleton, sauf que les gens meurent vraiment à l’écran. C’est cet écran qui occulte la réalité de ce qui se passe dans un pays. On peut être à quelques milliers de kilomètres d’un événement, on n’en est pourtant pas si éloigné que ça… J’ai commencé le scénario à ce moment-là et j’ai fait l’album pendant la guerre du Golf. Autant dire que j’avais matière à faire.
FT : D’un autre côté, tu te posais en tant que spectateur alors que Victor, lui, joue un rôle prépondérant puisqu’il va filmer sur le terrain. Et si tu t’es rendu compte de l’absurdité de la situation en voyant deux cadavres à l’écran, lui, il lui faut perdre une jambe pour ouvrir les yeux.
Mazan : Effectivement. Il voit des cadavres tous les jours sur les champs de bataille. Il fallait trouver quelque chose de plus fort, qui le touche personnellement et qui le remette sur les rails, qui lui permette de se rendre compte de la folie des événements. En parallèle, Grégoire et Paterne sont spectateurs. Si Paterne s’en fout, Grégoire, lui, voit les morts tous les jours et il aimerait bien savoir comment tout ça s’est passé. Le général Pinchault, lui, est carrément acteur. Ce qui m’a choqué, à l’époque, c’était le côté médiatisation de la guerre, la façon dont tout ça à été filmé, truqué, théâtralisé. Ça devenait du grand spectacle.
FT : Dans Ville Basse, tu décides de t’attaquer à la ségrégation raciale, à la lutte des classes.
Mazan : En effet. La ville haute, la ville basse… C’est un peu manichéen. Le Grand Mal et Lumière sur le Front sont deux albums un peu “compliqués”. Le premier parce que j’étais un peu jeune et j’ai cru que le public allait pouvoir suivre toutes mes pérégrinations intellectuelles. Il s’avère que quand on fait des ellipses un peu trop fortes, on perd le lecteur. Dans Ville Basse, j’ai voulu faire quelque chose de linéaire qui se termine bien. Tout ce que j’avais fait précédemment se terminait mal. Dans Aménophis 4, le personnage se suicide, dans Lumière sur le Front Grégoire se suicide, dans Le Grand Mal on se demande si ce n’est pas le monde qui est en train de se suicider… Je voulais, pour une fois, raconter une histoire d’amour.
FT : Pour Delcourt, tu adaptes des contes de Grimm. C’est un travail de commande ?
Mazan : Au départ, je voulais présenter le quatrième album de la série L’Hiver d’un Monde, mais vu le succès grandissant de la série, Guy m’a proposé d’essayer autre chose. Ce qui était loin d’être idiot de sa part. Il est vrai que je voulais faire des livres pour enfants un jour ou l’autre, mais pas précisément à ce moment-là. Lui était en train de monter une collection jeunesse et il m’a proposé de travailler soit sur un projet personnel, soit sur une adaptation d’un conte populaire. Nous nous sommes mis d’accord sur un conte de Grimm.
FT : D’où Le Vaillant Petit Tailleur…
Mazan : Au départ, je voulais adapter Apprendre à Frissonner. C’est une histoire qui m’avait marqué étant gamin. On me l’avait racontée à la maternelle et, contrairement au personnage du conte, ça me faisait vraiment frissonner. J’ai demandé à Guy de le lire, mais à l’époque, il pensait que ça ferait trop peur aux enfants. Il préférait un conte qui soit ni trop connu, ni pas assez, comme Le Vaillant Petit Tailleur. C’est d’ailleurs lui qui m’a poussé à adapter cette histoire en particulier. Ce qui m’intéressait aussi dans l’idée du conte en général, c’est cette quête d’un personnage qui va grandir, mûrir et passer du statut de gamin à celui d’adulte. Dans Apprendre à Frissonner, le père du personnage principal le traite de bon à rien, lui dit qu’il ne fera jamais rien dans la vie et celui-ci lui répond qu’il veut apprendre à frissonner. Quel beau métier ! C’est le côté : montrer à son père qu’on est capable de faire quelque chose dans la vie.
FT : Le personnage du Vaillant Petit Tailleur est en fait un personnage que tu as créé pour des travaux publicitaires.
Mazan : Le Philibert en question, qui est donc le héros du Vaillant Petit Tailleur et que je voulais d’ailleurs réutiliser pour Apprendre à Frissonner, mais Guy m’a dit qu’il ne fallait pas pousser (NDLR : il apparaît tout de même en page 16), vient effectivement de la publicité. Pour DHL, j’ai travaillé sur un album qui s’intitule La Malédiction de Philéas Fog. On a turbiné à 5 sur cet album. Philippe Gasc au scénario, Eric Dérian aux décors, Isabelle Dethan à l’encrage, une coloriste qui a plutôt saccagé l’album et je me suis occupé du story-board, des crayonnés et des personnages principaux. J’ai choisi un personnage qui soit toujours présent à l’image, où que tu puisses le placer, avec sa houppette rousse. Dans cet album, il était d’un style un peu plus réaliste que maintenant. Je l’ai arrondi pour en faire un personnage plus sympa. Il incarne Le Vaillant Petit Tailleur et je le réutilise pour ma prochaine histoire dans laquelle il s’appellera Philibert Mou.
FT : Et dans laquelle il sera médecin légiste !!!
Mazan : Pourquoi est-il médecin légiste ? Jean-Luc Loyer, le dessinateur des Mangeurs de Cailloux (chez Delcourt) qui sort son nouvel album (Victor, Le Voleur de Lutins) en même temps qu’Apprendre à Frissonner (Delcourt Jeunesse), est à l’origine de deux petits collectifs : L’Original et L’Invincible édités par Le Cycliste. Le troisième devait s’appeler L’Incurable et avoir pour thème les maladies, les médecins… J’avais trouvé une histoire de 7 pages avec un médecin légiste. L’Incurable n’étant jamais sorti, j’ai réutilisé cette histoire pour mon projet d’album chez Casterman : Dans l’Cochon Tout Est Bon. (NDLR : Les relations entre Mazan et Casterman ayant avorté, c’est Guy Delcourt qui éditera cette histoire.) Les personnages principaux sont tout maigrelets et autour d’eux il y a pas mal de saindoux.
FT : C’est le point de départ d’une critique de la société ?
Mazan : C’est plus une caricature qu’une critique. J’espère ne pas être méchant dans ma vision des choses. C’est vrai qu’il y aura beaucoup de personnages qui ne pensent qu’à manger, alors que Philibert est maigre et qu’il va s’amouracher de Léa, une jeune femme anorexique. Je ne vais pas me gêner pour les égratigner eux aussi. Tout le monde en prend pour son grade.
FT : Et toi, là-dedans, tu te places où ?
Mazan : Derrière et je rigole. Il y a un côté cynique, mais comme le dit Bernard Ciccolini de Casterman, c’est à la fois cynique et tendre. Ça pourrait se rapprocher de la vision du monde de Pascal Rabaté. Lui non plus n’est pas méchant. Il récolte de-ci, de-là, des phrases, des idées, des situations, des choses anodines mais extraordinaires, surtout dans la manière dont il les met en scène. Ce côté-là me plaît bien.
FT : Tu prévois une longue série ou bien des histoires complètes ?
Mazan : Plutôt des histoires complètes avec le même personnage ou avec son frère, Alcide Mou. Les histoires de Philibert seront basées sur l’amour ou le quotidien. Si je pars plutôt sur son frère, ce seront des petits polars dans lesquels je mettrais en scène, bien évidemment, le médecin légiste.
FT : Le gros projet à venir, c’est Dans l’Cochon Tout Est Bon, avec Philibert, mais tu as d’autres choses en préparation ?
Mazan : J’ai plein d’histoires en tête. Notamment ce qui aurait dû être le quatrième tome de L’Hiver d’un Monde. Une histoire qui se passe au Pôle Nord et avant Le Grand Mal. Une sorte de polar polaire qui verra peut-être le jour avec Alcide Mou… Il m’a fallut 2 ans pour faire Ville Basse et ça n’a pas été 2 ans à fainéanter. Je n’ai pas pris de vacances depuis 3 ans. J’ai l’impression que mes vacances ce sont les festivals. Or, quand j’en reviens, j’en suis encore plus fatigué qu’en partant. Mes dernières vacances, je les ai passées au Vietnam avec Gabrion et Jean Solé. L’Alliance Française avait organisé des expositions et des dédicaces à Hanoï. On a fait 2 heures de dédicaces et le reste du temps était libre. J’ai fait plein de croquis, mais je me suis fais voler mon carnet de croquis pendant un festival. L’équipe Delcourt a été très sympathique. Elle m’a offert un carnet de croquis off. Chaque dessinateur m’a fait un dessin… Toujours est-il que rencontrer ces gens, vivre 8 jours dans ce pays étrange pour moi qui ne suis quasiment jamais sorti du territoire, voir ce qui s’y passe, aller discuter dans les campagnes avec des Vietnamiens, c’est nourrir son imaginaire. Toutes ces expériences mises bout à bout font qu’on devient un auteur… Enfin, j’espère.
Propos recueillis par Franck Debernardi.